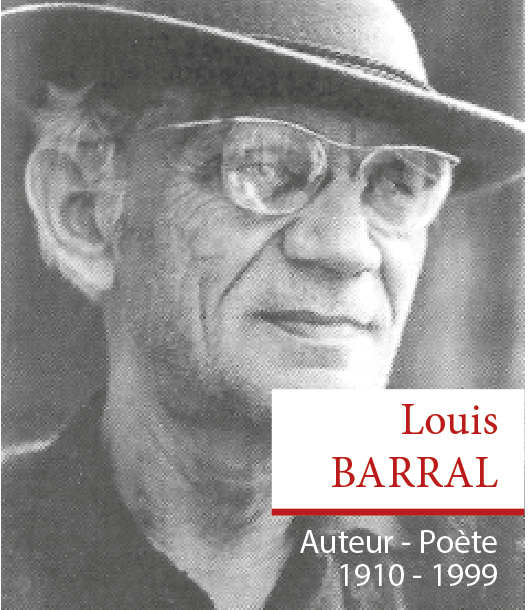ASSOCIATION
pour la DÉFENSE du
PATRIMOINE COMMUNAL du pays d'Annot
(04240)
-
- Qu'est
ce que l'ADPC ?
- Les rues et les places
- Les édifices et les monuments
- A deux pas d'ici...
- Au XXIème siècle
- Les templiers à ANNOT
- Noël à ANNOT
- Cartes
postales NB
- ✩=
Ctrl + D
Les
découvertes des grottes de Saint Benoît
Les
collections de mobilier archéologique exposées, proviennent des
fouilles menées de 1953 à 1954 par Louis Barral, Conservateur du Musée
d’Anthropologie de Monaco.
Elles
ont fait l’objet d’un prêt de ce Musée à la Municipalité d’Annot, afin
qu’elles puissent être présentées au public dans le cadre de
l’ouverture du Musée municipal d’Annot. La nécessité de remettre en
lumière ces collections, à l’initiative de Jean-Louis Damon avec l’aide
de Gilles Loison, archéologue et de Pierre Bonnet, a favorisé la
création d’un espace qui leur sera désormais consacré et qui a pour
vocation de devenir une salle dédiée à l’archéologie locale.
Provenance
des collections des grottes de Saint Benoît
C’est à 7 km d’Annot, après le Pont-de-Gueydan, au sortir du tunnel
emprunté par la RN 208, que s’ouvrent les grottes de Saint Benoît dans
un escarpement presque vertical d’environ 100m de haut.
Ces
cavités se développent au sein des calcaires Lutétiens. Lors des
investigations menées par Louis Barral (Barral et al.1955), celui-ci ne
leur a pas attribué de nom, mais seulement un numéro d’ordre.
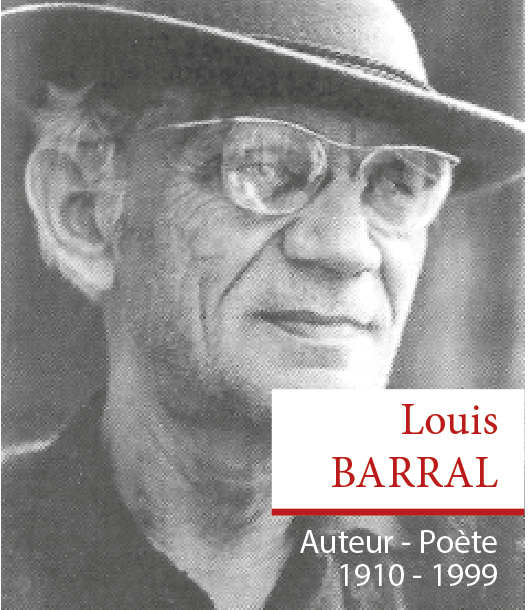
Il
s’agit de la grotte II, de la grotte I son diverticule et de la grotte
III (dite des Echelons) située à leur aplomb 22m plus haut.
Il
apparaît que la grotte principale appelée grotte de Saint-Benoît,
comporte trois entrées : l’entrée de la grotte elle-même, la grotte de
la Lare, et la sortie des Perles.
Des
premières observations aux premières investigations scientifiques
Les premiers à avoir occupé ces grottes ont été les hommes du
Néolithique moyen.
De
nombreuses traces d'incursions ont été observées jusqu'à 288 m et 361 m
de l'entrée. Quelques vestiges épars attestent également de présences
au Néolithique final et au début de l’Âge du Bronze.
Au
début du XIXème
siècle, le docteur Feraudy d’Annot remarque de nombreux ossements
humains dans la grotte de la Lare et fait part de sa découverte à M.
Rabiers-du-Villars, sous-préfet à Castellane, qui visite en 1817 la
grotte en compagnie de D.-J.-M. Henry, comme l’atteste la signature de
ce dernier apposée au-dessus d’une date ancienne de 1649.
En
1872, Girard de Rialle, membre de la Société d’anthropologie de Paris,
explore les grottes et y pratique, vraisemblablement les premières
fouilles.
Plus
récemment, on note également la visite de Michel Siffre le 29 juillet
1952, qui fait ici ses premières expériences de spéléologue, puis celle
de l’archéologue L. Barral et de son assistant N. Rosatti le 20 avril
1953 qui reconnurent la grotte II.
La
grotte III ne fut atteinte par eux que le 24 mai 1953.
Les travaux de l’équipe du Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco
Les investigations dirigées par L.Barral, elles ont eu lieu du 18 mai
1953 au 7 novembre 1954.

Dans la grotte I,
l’ordonnancement des couches avait été bouleversé par les fouilles
antérieures. Néanmoins les fouilleurs ont pu constater la présence de
nombreux restes osseux et humains et de pierres pouvant être des
indices de probables sépultures en pierrier du Néolithique.
Le
mobilier céramique recueilli fait apparaître des mélanges
chronologiques. Certains vestiges appartiennent au Néolithique final,
d’autres au Bronze ancien/moyen.
Dans la grotte II,
les fouilleurs ont traité également des couches remaniées. Parmi les
tessons de céramique recueillis, plusieurs périodes du Néolithique sont
représentées : le Chasséen ancien, le Chasséen récent et le Néolithique
final de type Ferrières. Cependant, une fouille a été effectuée dans
les couches en place sur 50 m2, en relation avec
la coupe I.
Ainsi
3 couches ont pu être distinguées : A, B et C. (la couche A étant la
plus récente).
Les éléments céramiques recueillis dans chacune des couches présentent
de nombreux caractères du Chasséen récent, mais également des éléments
plus récents, ce qui pose le problème de l’homogénéité des ensembles
sédimentaires, nécessitant un nécessaire réexamen.
Dans la grotte III
supérieure, dite "des Echelons", les archéologues y ont trouvé de
nombreux ossements humains pris dans la calcite et des tessons épars,
qui attesteraient de l’existence d’une grotte sépulcrale.
En
résumé, les découvertes faites par l’équipe de L.Barral au sein de ces
trois cavités, bien qu’issues de couches en grande partie bouleversées,
apportent de nombreuses et importantes informations sur la présence
Chasséenne de la vallée de la Vaïre, période la mieux représentée.
Les
occupations semblent avoir été consacrées à des espaces funéraires,
bien protégés par les difficultés d’accès, modes d’inhumation reconnue
dans le Sud-Est de la France (De La Briffe, Loison, Lea, Hasler 2007).
Cette
collection faite de vestiges céramiques, lithiques, osseux, est
remarquable et d’un intérêt scientifique évident.
Sa
présentation permettra de la porter à la connaissance de la communauté
scientifique afin d’en faire un opportun réexamen.
Gilles
Loison,
archéologue
retraité de l’INRAP et de l’UMR 5608 du CNRS
ancien
enseignant à l’Université Paul Valéry de Montpellier