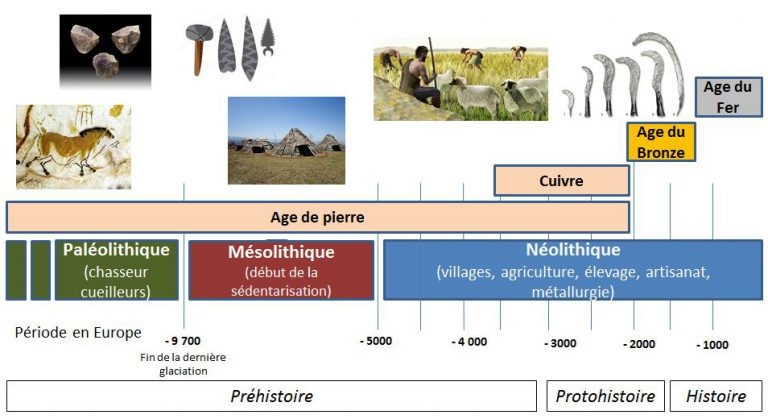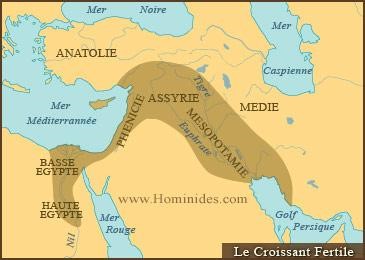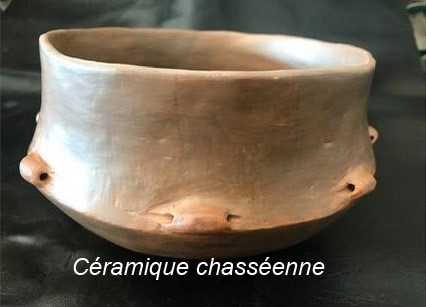ASSOCIATION
pour la DÉFENSE du
PATRIMOINE COMMUNAL du pays d'Annot
(04240)
-
- Qu'est
ce que l'ADPC ?
- Les rues et les places
- Les édifices et les monuments
- A deux pas d'ici...
- Au XXIème siècle
- Les templiers à ANNOT
- Noël à ANNOT
- Cartes
postales NB
- ✩=
Ctrl + D
Qu’est-ce
que le Néolithique ?
Vers
10 000 ans avant notre ère, un réchauffement climatique irréversible,
modifie les conditions d’existence des dernières populations
préhistoriques.
Celles-ci
abandonnent un mode de subsistance essentiellement prédateur, telles
que la chasse, la pêche et la cueillette, pour désormais s’orienter
vers des activités de production : la domestication des animaux et des
végétaux.
C’est
le Néolithique.
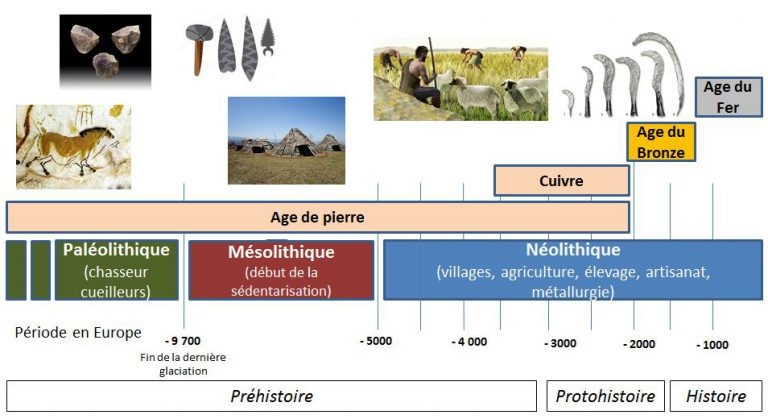
Son
origine se situe au Proche-Orient, dans une zone appelée "le croissant
fertile" à partir de 9500 avant notre ère.
Il
apparaît plus tardivement
en France sur la côte méditerranéenne autour de 5500 avant notre ère.
Ce
processus irréversible, qui porte les prémices du monde moderne, a
apporté la sécurité alimentaire, créé des surplus, transformé la nature
vivante.
Pour
la première fois de son apparition, l’homme tentait de maîtriser la
nature et s’en affranchissait avec comme conséquence un développement
démographique sans pareil.
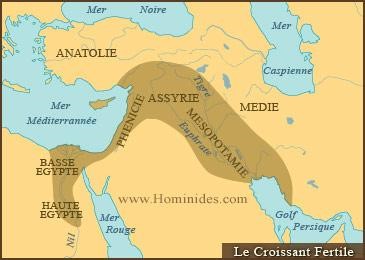
Son
apparition est un saut évolutif considérable pour l’espèce humaine,
l’une des transformations fondamentales qu’a connue l’humanité.
Le
néolithique moyen et la culture chasséenne
Vers 4700/4500 avant notre ère, le processus de néolithisation, débuté
au Néolithique ancien, semble achevé.
La
plupart des populations pratiquent majoritairement l’économie de
production et sont sédentarisées.
Cette
époque voit l’émergence du Chasséen ancien (en raison du site référent
de Chassey en Bourgogne), culture unificatrice, qui inscrit
progressivement son impact, vers le Nord.
Dans
la deuxième partie de ce Néolithique moyen, à partir de 4200 avant
notre ère, cette culture chasséenne est particulièrement dynamique et
va diffuser son influence sur une grande partie du territoire national
(circulation de matières premières, échanges).
Il
s’agirait là de la première grande civilisation française.
Les
productions céramiques sont très caractéristiques. Les récipients sont
presque exclusivement à fonds ronds et aux parois très soigneusement
polies.
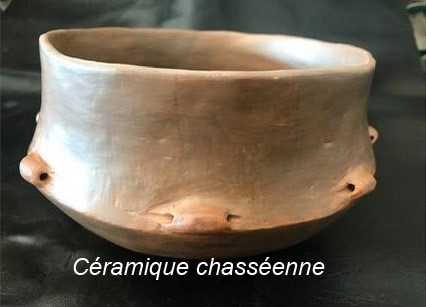
Les
formes sont variées montrant une grande diversité de fonctions.
Certaines
sont équipées de protubérances perforées verticalement (en flûte de
pan) ou horizontalement, dans le but de les suspendre dans l’habitat.
Le
Chasséen méridional reste également attaché aux productions de belles
lames caractéristiques, détachées par pression à l’aide d’une béquille,
œuvre probablement de spécialistes.
Cette
unité culturelle semble se dissoudre autour de 3500 avant notre ère
dans une multiplicité de groupes régionaux.
C’est
le Néolithique final.
Durant
cette nouvelle période, sur le plan de l’organisation sociale
économique et technique, rien ne change fondamentalement des tendances
déjà amorcées auparavant : conquêtes de nouveaux espaces, biens de
prestiges échangés à longues distances, comme les grandes haches
polies, enceintes de plus en plus grandes…
Le
véritable changement viendra à la fin de cette période, vers 2500 av.
notre ère, avec l’apparition de la métallurgie du cuivre.
Gilles
Loison,
archéologue
retraité de l’Inrap et de l’UMR 5608 du Cnrs
ancien
enseignant à l’Université Paul Valéry de Montpellier.